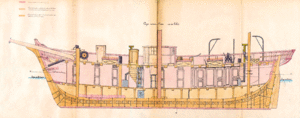Après la pêche au hareng, les Dunkerquois se lancent dans la grande pêche à la morue "à Islande". Partant pour six mois en mer, les marins laissaient leurs familles dans l’angoisse...
Dès son origine, Dunkerque pratique la pêche au hareng. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, cette activité domine, puis les Dunkerquois s’orientent vers la pêche à Islande. Ils s'inspirent des techniques et des pratiques hollandaises dont ils copient le bateau, appelé "dogre", à l'occasion d'une prise de guerre. Partis de mars à septembre, ils pêchent le long des côtes.
Contrairement à la pêche sur les grands bancs de Terre-Neuve, où les marins quittent leur bateau pour pêcher à partir de leur doris (embarcation à fond plat), les Dunkerquois restent à bord.
Chacun occupe un poste de pêche jusqu’à la fin de la campagne. Ils s’alignent le long du plat bord face au vent, protégés tant bien que mal par un tablier de grosse toile ou de cuir et les mains emmitouflées dans des mitaines. Les marins se servent d’une simple ligne munie de deux hameçons, qui peut mesurer de 40 à 240 mètres de long. Pour pêcher de cette façon, le navire doit être stoppé afin que les lignes soient à la verticale dans l’eau.
Cette manoeuvre, la dérive, s’effectue en maintenant le bateau en travers du vent et du courant. Le poisson est vidé et nettoyé à bord. Contrairement à ce que les Paimpolais pratiquent, il n’est pas mis en cale directement avec du sel. Après avoir subi différentes opérations, la morue dunkerquoise est conservée salée dans des tonneaux (appelés "tonnes") jusqu’au retour à Dunkerque, où elle est lavée et pesée par les femmes et remise en tonnes.
Pour ces opérations, nommées "paquage de mer" et "repaquage de terre", les Dunkerquois, à l’instar des Hollandais, emploient du sel blanc qu’ils vont chercher eux-mêmes sur les côtes du Portugal, celui-ci étant considéré meilleur que le sel breton. Dunkerque est le seul port français avec Gravelines à pratiquer ce type de conservation qui fournit un poisson de meilleure qualité mais plus onéreux.
Commercialisée dans l’arrière-pays, la région parisienne et l’est de la France, la morue salée fait la richesse de certaines familles d’armateurs qui exercent également d’autres activités maritimes : Vancauwenberghe, Bonvarlet Frères, Durin, Govard, Beck, Verharne ou encore Bellais. Ils arment trois à dix bateaux par an et peuvent employer plus de 200 personnes.
D'autre part, la pêche à Islande génère une intense activité économique qui lui est associée : la construction et la réparation navale, les gréeurs, fabricants de toile à voile, tonneliers, ateliers de repaquage...
La pêche à Islande se pratique dans des conditions climatiques extrêmes : les tempêtes sont fréquentes, et jusqu’au début du XXe siècle, le balisage est inexistant. Les bateaux ne disposent d’aucun moyen moderne de navigation. De fréquents accidents en découlent. Certaines années sont catastrophiques : 185 marins disparus en 1839 et 165 en 1888. Aussi, avant de partir pour six mois et, peut-être, ne jamais revenir, les pêcheurs font la fête. La “vischersbende” (bande des pêcheurs) du carnaval en transmet encore aujourd'hui le souvenir...
Considérant la "grande pêche" comme une pépinière de marins aguerris pour le service de la Royale, l’État a toujours encouragé cette activité, avec des tarifs protectionnistes à l’importation, des primes à l’exportation ou des subventions aux armements. La rémunération des marins, inspirée de la coutume hollandaise, se calcule au "last".
Ce mode de paiement est composé d'une part fixe (avances et primes à l'engagement) et d'une part proportionnelle, calculée à partir de la pêche du navire calculée en "last" (un last est égal à douze tonneaux de 134 kilogrammes de morue). Rémunéré au rendement, tout l'équipage est ainsi intéressé au résultat de la campagne.
De 1763 à 1792, l’activité se développe considérablement grâce à un accord entre la France et le Danemark, autorisant les navires français à pêcher sur les côtes d’Islande. La flottille compte régulièrement une soixantaine de navires. Le cadre réglementaire de la plus importante activité dunkerquoise du XIXe siècle est fixé dès le XVIIIe siècle. Techniques de pêche et de conservation du poisson, rapports entre les marins et les armateurs, intervention de l’État... autant de données qui demeurent inchangées au XIXe siècle où seuls les bateaux et l’ampleur de l’activité évoluent.
À la Restauration, les capitaux manquent et la reprise se fait doucement. Il y a peu de navires disponibles et beaucoup sont anciens, mais progressivement les chantiers de construction navale sortent de nouvelles unités. Durant la première moitié du XIXe siècle, la flottille augmente régulièrement et les lourds dogres font progressivement place à la goélette. S’il ne s’agit pas d’une invention dunkerquoise, Gaspard Malo a cependant l’idée de modifier la goélette existante en adoptant le gréement des goélettes américaines de l’époque, réputées pour leur élégance et leur vitesse. Nommées goélettes Balaou, elles deviennent le bateau emblématique de la pêche dunkerquoise.
Au milieu du XIXe siècle, cette activité prend un tel essor que les chantiers de construction navale, situés dans l’arrière-port, ont peine à fournir tous les bateaux commandés par les armateurs. L’apogée de la pêche à Islande se situe entre 1850 et 1870 : plus de cent navires s’en vont chaque année vers "l’Île de glace". L’équipage est composé de 14 à 18 hommes, selon la taille du navire.
Durant cette vingtaine d’années, environ 35 000 marins franchissent les jetées de Dunkerque. L’organisation à bord est immuable : le capitaine, titulaire au minimum d’un brevet de maître de pêche, est secondé par les "principaux de l’équipage" qui sont le second, un ou deux lieutenants, le saleur et le tonnelier. Viennent ensuite les matelots-pêcheurs, le novice et le mousse. Les capitaines sont choisis par les armateurs.
Il existe de véritables dynasties de capitaines, tels les Carru, Hars, Vanhille, Popieul, Evraert, Vanraet, Wallyn, Benard et Agneray. Les matelots ont au moins dix-sept ans, les novices quinze et les mousses une dizaine d’années.
À chaque campagne, ces hommes partent pour six mois d’une vie rude et dangereuse. Aussi tentent-ils de se regrouper par affinités familiales ou amicales. Lorsqu’une catastrophe survient, elle endeuille des villages entiers et décime certaines familles. Les tempêtes d’avril 1888 noient huit membres de la famille Marteel.
Toute la ville vit au rythme des campagnes d’Islande. Au moment des départs, ou après les dévotions à Notre-Dame des Dunes, l’ensemble de la flottille s’en va sur deux ou trois jours, créant une fantastique pagaille où plus de cent navires se présentent à la seule écluse existante.
Puis, les rares nouvelles parvenant d’Islande sont avidement commentées alors que leur absence entretient l’angoisse des familles. Le retour s’effectue sur une quinzaine de jours. Les quais sont alors complètement encombrés des tonnes débarquées et, tandis que des bateaux et ateliers de repaquage s’échappent de puissantes odeurs de poisson, le port retentit du cri des enfants qui jouent dans l’enfléchure des goélettes... Le calme revient à la mi-octobre, mais le bassin du Commerce est complètement saturé de navires jusqu’au prochain départ pour l’Islande.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les Dunkerquois sont pratiquement les seuls Français à fréquenter les eaux islandaises, mais en 1852 un armateur de Paimpol fait appel au capitaine François Druel de Mardyck pour commander la première goélette bretonne. Dès lors, les Bretons côtoient régulièrement les Flamands.
La véritable concurrence vient de la morue pêchée par les chalutiers et conservée dans la glace. Les nouvelles habitudes de consommation, une pêche de plus en plus intensive et la baisse des prix de revient qui en découle, entraînent dès 1880 le déclin de la pêche dunkerquoise à la morue, techniquement figée depuis plus de deux cents ans.
À la veille de la Première Guerre mondiale, seuls 21 navires font route vers Islande. Au lendemain de l’armistice, la flottille est transférée à Gravelines où elle périclite progressivement jusqu’au 22 février 1938, jour où le "Saint-Jehan" appareille pour la dernière fois.